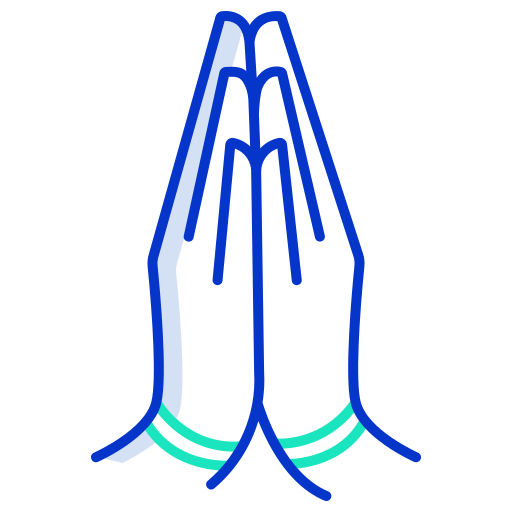LBCV est une primevère
Février 2025
J’ai fait un rêve canon : il neigeait fort depuis un bout, je regardais frissonner les érables de l’autre côté de la fenêtre, ressentais un apaisement profond, convaincu que je venais d’emménager dans un espace de parole retrouvée. Un espace de libre parole. Un nid de parole libérée. Un cocon de mots qui n’avaient plus peur de leurs signifiants. Les ailes de la joie papillonnaient dans ma poitrine. La petite voix chaude de la marmotte d’en face répétait son mantra : « libre, gratuite, en accès libre, arbitrée par le libre arbitre, réhabilitée par la connaissance du sens de l’histoire, l’esprit critique et le retour du bon vieux bon sens… »
Quelques fractales plus tard, grand soleil doré trouant le grand ciel outremer, marmotte disparue, même lieu, la tête écrasée entre les mains c’était la prise de tête : rêve ? fantasme ? illusion ? déréalisation ? Le blaireau d’en face me trouvait débile : « Un espace comme ça tu te souviens juste que ça a existé un jour, maintenant c’est mort. »
Impossible. Cet espace-temps on en a besoin. Bon. Je vais le créer et l’offrir.
Comme petit nom à peindre sur la porte d’entrée en pain d’épices de ce nouveau refuge en haute montagne, j’ai d’abord pensé à Cet obscur objet du désir.1 Bon, je crois que c’est déjà pris. Le goût des autres, aussi.2 J’ai pensé aussi à Les mots pour le dire.3 Mouais… bof… pour le dire ? le quoi ? dire quoi ? mélodramatique, prière de laisse tomber. Sinon, il y avait aussi D’autres vies que la mienne mais bon, oula ! …4
Un flux traverse mon bureau, d’un coup d’un seul. Je fais un courriel à Élise. Élise dit oui. Le Bruit des Choses Vivantes naît.
LBCV c’est toi, c’est moi, c’est toi et moi, c’est vous et moi, c’est elle et moi, , i·el et moi, lui et moi, vous, nous, en tête à tête, deux micros, zéro caméra, zéro photo, un thème d’accroche et la liberté de s’en affranchir.
LBCV c’est un espace dématérialisé, inventé de toutes pièces pour favoriser les conversations entre humains (« les quoi ? » mais si, les humains, nous ces êtres merveilleux), un voyage auditif au cours duquel l’écoute et l’altruisme ne souffrent d’aucun préjugé, n’ont ni œillères bestiales ni frontières terrestres.
LBCV c’est une émission immersive diffusée sous forme d’épisodes d’une trentaine de minutes, en accès libre, réalisé bénévolement.
LBCV c’est hors bric-à-brac contemporain affligeant, on se détend, on est là, ensemble, pour s’apprécier et on le partage.
2025 : le début d’une ère inhumaine envahie d’un vacarme artificiellement intelligent ?
LBCV : les Choses Vivantes que nous sommes continueront de faire Leur Bruit.
Et si on restait naturellement intelligents ?
Notes : 1 – Cet obscur objet du désir, film réalisé par Luis Buñuel, 1977. 2 – Le goût des autres, film réalisé par Agnès Jaoui, 2000. 3 – Les mots pour le dire, roman de Marie Cardinal, 1976. 4 – D’autres vies que la mienne, récit d’Emmanuel Carrère, 2009
***
Louis, Suzie et moi 1
Janvier 2025
Louis est bipolaire.
Je n’ai connu ni la santé mentale de sa mère ni sa voix.
Quand Félix le père levait la pointe de son Opinel, la mère Suzie recevait l’onction de s’asseoir à table parmi nous et devait avaler ses pilules sans broncher. Nous attendions religieusement qu’elle s’exécute avant de prendre nos fourchettes. La viande était trop cuite et le riz sentait mauvais. Maman me susurrait : « Ne crains rien, mon chéri, je suis là, on s’en va bientôt. »
Sans adieux, éperdument seule, à l’isolement, Suzie est décédée après dix ans d’asile. À la mention cause sur l’acte de son décès est écrit : mélancolie.
Trois mois après les funérailles de Suzie, Félix s’est remarié et Louis, devenu chômeur, a décompensé. On l’a déclaré fou. HDT 1. Contention, isolement, sédations. HDT 2. Contention, isolement, sédations. HDT 3… HDT = Hospitalisation à la Demande d’un Tiers. Puis, enfin consentant, deux cures de repos. Quatorze années de brouillard. Et le diagnostic.
« En justice, l’un dit : je suis innocent. En psychiatrie, l’autre dit : je veux sortir. La liberté, même si elle repose sur quelque chose… je ne suis pas un malade mental… Dans l’hôpital psychiatrique, tous les patients ont une histoire presque littéraire. » 2
Au cours de mes reportages photographiques, j’ai mémorisé des lumières vides, enregistré l’inanimé de foules, pénétré des présences obscures et poursuivi mes ombres défilantes. Portraits de nos folies génétiques ? Dans l’effacement du voyeur je traversais nos absences respectives. Revenant, face aux albums de famille, à haute voix je questionnais : es-tu photographiable, bipolarité ? Ses regards vers le hors champ présageaient-ils de la douleur tue de Suzie ? Ses sourires esclaffés annonçaient-ils les malheurs criés de Louis ? Il exagérait des récits, donnait son avis à propos de livres prétendument lus, de films supposément vus, détestait les conflits, se proclamant tout à tour pacifiste pro guerre ou pollueur écologiste boursicoteur.
Depuis la Peugeot 203 de Félix, Louis était fasciné par les voitures. Il en a acheté tellement que les huissiers se sont régalés. Comme il disait s’ « en branler », même après avoir perdu son permis de conduire et sans plus d’assurance, il continuait de rouler jour et nuit à l’instar de Jean-Louis auquel il s’identifiait. 3
Puis, il a acheté un bateau. Bien avant la création d’asiles dans les cités, on embarquait les fous sur des galères soi-disant pour leur bien, surtout pour les éloigner des sains d’esprit. Une fois au large, les cas les plus désespérés pouvaient être jetés par-dessus bord. La traversée soignait la maladie. 4
On ne dit plus ni fou ni maladie, mais trouble de santé mentale. Trouble est un euphémisme. Un anglicisme. Plus besoin de prononcer le problème. Santé indique que la personne n’est pas malade, tout au plus a-t-elle un tracas si infime qu’elle ne saurait s’en plaindre. Mentale est flou. Trouble. Plus de personnes troublées = moins de malades nets = politique d’aide psychosociale satisfaisante = remède ?
S’il n’est jamais souhaitable d’insulter, dire / écrire malade mental pouvait participer à l’élaboration du binôme maladie / identité dans le but d’accompagner ce couple déchiré vers son soin. Nos mots nouveaux ne résoudront ni nos problèmes ni nos maux. Ils nous induisent en erreur. Ils minimisent, culpabilisent. Paravents d’une détresse qui croît en silence. Lorsque plus personne ne saura se constituer souffrant, le soin sera devenu chimère et l’amour altruiste empêché.
Et si on disait / écrivait mental malade ?
Notes : 1 – En référence au film Thelma et Louise de Ridley Scott (MGM-Pathé Communications, 1991), au roman-photo Suzanne et Louise de Hervé Guibert (Paris, Gallimard, 1980) et au roman autobiographique Thelma, Louise et moi de Martine Delvaux (Héliotrope, 2018). 2 – En 1980, Raymond Depardon a réalisé le documentaire San Clemente avec Sophie Ristelhueber dans un asile psychiatrique près de Venise avant sa fermeture définitive. Les patients y déambulent sous le regard complice d’une caméra à l’épaule, souvent filmés en plan séquence, évocation poétique de la vie dans cet ancien monastère. En 1987, il Urgences, tourné aux urgences psychiatriques de l’Hôtel-Dieu de Paris, documentaire qui témoigne de moments de crises et qui montre le visage brutal et extraverti de la folie. En 2017, il a réalisé 12 jours, trente ans après San Clemente, ce titre faisant allusion au délai introduit par une loi concernant l’internement psychiatrique sans consentement. Dans La beauté et les oubliés, un entretien audio avec Raymond Depardon et Claudine Nougaret réalisé par Jonathan Chalier et Emmanuel Delille à propos de 12 jours, à la question : « Tout compte fait, avez-vous réalisé un film sur la justice ou la psychiatrie ? », Raymond Depardon répond : « Il y a quelque chose qui me touche dans la psychiatrie ; on pourrait refaire un film. En justice, l’un dit : Je suis innocent, l’autre : Je veux sortir. Je suis plus proche du gars qui veut sortir. La liberté, même si elle est irrationnelle, même si elle repose sur quelque chose… je ne suis pas un malade mental… cela me touche plus. Dans l’hôpital psychiatrique, tous les patients ont une histoire incroyable, presque littéraire. Nous avons très longtemps gardé des plans d’une jeune femme qui venait de l’unité des malades difficiles. […] Elle était douce et gentille. On m’a dit qu’elle mettait le feu partout, qu’elle était pyromane. C’est magnifique ! Si je devais faire de la fiction, je ferais un film sur les raisons qui la poussent à mettre le feu partout. » 3 – Lelouch Cl., « Un homme et une femme », long-métrage avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, France, Les films 13, 1966. 4 – Foucault M., « Stultifera navis », Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1972, Chapitre 1.
***
Fermer une école est un aveu d’échec
Mars 2024
J’ai mis fin à mes études à l’École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie le lundi 19 février 2024, le jour de l’annonce de la fermeture du pavillon de Montréal prévue pour juin 2027.
L’ÉNMÉ : une école ouverte il y a trente ans à l’angle des rues Masson et De Lorimier dans un bâtiment fonctionnel répondant à des normes d’installation spécifiques et des critères techniques complexes nécessaires à la maintenance de la machinerie et à la sécurité des étudiants et du personnel. En face des lofts Cadbury, dans le quartier historique des artisans professionnels où se croisent tous les jours plombiers, mécaniciens, chaisiers, designers, sculpteurs, concepteurs, maçons, carrossiers, maroquiniers, menuisiers, charpentiers, joailliers, spécialistes du cuir, luthiers, ébénistes, dessinateurs industriels, opérateurs de commandes numériques, ferblantiers, doreurs, peintres, restaurateurs, prototypeurs.
L’ÉNMÉ avait tout pour continuer à en être l’une des plaques vibrantes. Si on n’allait pas trop vite. Si les décisions administratives n’étaient pas d’ordre financier, déconnectées du quotidien. Si on donnait le temps aux plus jeunes de se familiariser avec des métiers exigeants, contraignants, fatigants, potentiellement dangereux certes, mais si précieux, indispensables, si satisfaisants, gratifiants. Pour que des étudiants de 16 à 70 ans continuent d’avoir les yeux qui brillent quand ils parlent de leur passion, de leur savoir-faire, gorgés des connaissances nécessaires pour transformer avec dextérité des matières naturelles, nobles et vivantes, tentant de répondre aux exigences d’une clientèle qui subit le contre-coup des récentes hausses vertigineuses des prix des matières premières tout en faisant déjà face à une pénurie de main d’œuvre.
Pénurie d’artisans professionnels, mais également pénurie d’étudiants et, nous le savons, pénurie de professeurs qualifiés dans les écoles. Il est aisé de comprendre que l’équation est bancale, qu’il s’agit là d’un seul et même manque : pénurie de foi en notre avenir en tant que société juste. Angoisses de performance, écoanxiété, financements publics déséquilibrés, peur du lendemain, robotisation des techniques industrielles et agricoles, augmentation délirante des troubles de santé mentale, intelligence artificielle envahissante, analphabétisme et illettrisme, et, pour finir, pénurie de personnel infirmier, de médecins et de psychothérapeutes. Tout est lié. Nous avons beaucoup de bonnes raisons de nous inquiéter, mais commencer par fermer des écoles n’apportera que frustrations, méfiance et désillusions. Cela n’aidera en rien à nous réparer en tant que communauté. La fermeture de l’ÉNMÉ a de fortes chances d’être un arbre qui cache la forêt lacustre.
Je suis titulaire d’un baccalauréat scientifique spécialité mathématiques, option allemand et arts plastiques, d’un brevet de technicien supérieur audiovisuel option montage et d’une licence d’études cinématographiques à l’Université Paris-Diderot. J’ai exercé les métiers de chef-monteur et directeur de postproduction, photographe auteur et professeur de journalisme. Je suis également artiste visuel.
Après trop d’années passées à Paris, je n’en pouvais plus. Je voulais quitter la France et changer de métier, exercer une profession moins productiviste, utiliser mes mains pour créer. J’avais une belle situation, de bons salaires. Je louais un appartement de taille correcte dans un beau quartier, la propriétaire était une femme en or, solidaire des artistes et des travailleurs autonomes créatifs. J’avais des amis solides, un médecin de famille comme on n’en fait plus, la sécurité sociale, une complémentaire retraite et une assurance mutualiste. Mais la disparition de la presse papier et les nouvelles chaînes tout info eurent raison de mes convictions journalistiques. La gestion politisée de l’école où j’enseignais me semblait obscure. L’émission culturelle pour laquelle je travaillais régulièrement n’allait plus être produite après sept années de courbes d’audiences honorables. J’étais en procès aux prudhommes contre un ancien employeur aux tendances esclavagistes. Les photographes indépendants crevaient de faim à force de se faire piller leurs droits d’auteurs sur les réseaux sociaux. Les alarmes hurlantes des téléphones intelligents commençaient à m’agresser. Kirielles de courriels le matin au réveil, de copies de copies de copies de courriels… SMS à n’en plus finir des rédacteurs en chef qui couraient dans tous les sens, dans les loges et sur les plateaux de télévision, pour couvrir le moindre fait divers non vérifié. Une année complète de manifestations outrancières contre le mariage pour tous, les Parisiennes et les Parisiens LGBTQ+ s’en sont pris plein la gueule. Dix-huit mois d’attentats terroristes partout en Europe, détonations des kalachnikovs sur les boulevards de la République, les terrasses des cafés, dans les salles de concerts, bombes mutilantes aux abords des stades, patrons décapités, flics assassinés, prêtres égorgés. Les trente actes des gilets jaunes chaque samedi pendant deux ans, avec les magasins incendiés, l’atmosphère lacrymogénisée, les assauts des black blocks, les violences policières, manifestants aux membres arrachés, mères de famille aux yeux crevés, hausse historique des scores des partis extrémistes aux élections… La liste est longue, je vous assure. Il faut beaucoup aimer Paris. Beaucoup, beaucoup aimer Paris.
J’ai visité l’ÉNMÉ que la directrice d’alors m’a vanté être, je cite, « la meilleure école supérieure d’ébénisterie en Amérique du Nord » – rien que ça, oui j’ai été naïf – et, conquis, je suis rentré à Paris finir de travailler, d’enseigner et j’ai organisé mon immigration. J’ai fait ma demande de permis d’études et la Covid-19 a changé la face du monde. Neuf mois plus tard, une valise et un sac à dos, acte de mariage, certificats médicaux et passeport européen en main, masque chirurgical sur le visage, j’ai été autorisé à immigrer au Canada sur le tarmac désert de l’aéroport désert de Roissy-Charles-De-Gaulle par un officier des instances douanières qui avait autant de pouvoir qu’un policier. Un verre d’eau, rien d’autre, pendant sept heures de vol.
Une fois installé à Montréal, la situation épidémiologique mondiale a eu pour conséquence de retarder mon entrée à l’ÉNMÉ puisque je n’ai pu obtenir mon permis d’études à temps pour la rentrée d’automne. J’ai demandé au bureau de mon député d’intervenir auprès des services d’immigration et le ministère de l’enseignement supérieur m’a autorisé à commencer mes études en distanciel, mais la direction de l’école, qui siège à Victoriaville, a refusé, sans me donner d’explications. C’est en prenant le risque de faire le célèbre tour du poteau sept mois plus tard, faisant fi des conseils de mon avocate, que j’ai réussi à obtenir mon permis d’études de la part d’un douanier humiliant – m’obligeant à une énième quatorzaine sans raison – pour entériner mon inscription à l’ÉNMÉ et commencer à la session de l’automne suivant. Enfin, j’allais entrer dans le Monde de l’Ébénisterie. L’attente avait été longue, mes ambitions avaient grandi. J’étais confiant, optimiste.
Quand ma rentrée est arrivée, la première post-covid, les travaux de rénovation de l’école étaient presque terminés, les locaux flambants neufs. La cafétéria et l’espace pour les repas avaient été repensés, mis aux normes. La salle d’exposition était équipée pour organiser des rencontres et des conférences. La salle de cours magistraux au quatrième étage était pourvue d’un grand écran tactile idéal pour les cours de dessins 2D et 3D. Au troisième étage, une salle de classes dédiée à l’étude des bois et aux matériaux connexes, magnifiquement agencée. Nouveaux bureaux, nouveaux fauteuils, mais aussi nouvelles machines dans les ateliers du deuxième étage, rutilantes, modernes, sécurisantes. Une salle entièrement dédiée au placage traditionnel, j’y ai passé des soirées entières pour mon plus grand bonheur, j’y ai tellement appris, le goût du détail jusque dans les moindres couches de bois, la recherche de la perfection, la note aigue de la scie à chantourner, la fabrication d’échiquiers en essences indigènes et exotiques, dessus pour cabinets de curiosités marquetés, le concours de boiserie ornementale organisé conjointement avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal). Nouveaux bancs de scie sécurisés, planeurs numériques, presses thermiques, commandes numériques à trois axes, salles informatiques hyper connectées, ateliers libres le soir pour avancer des exercices de cours ou s’aventurer à des projets personnels, toujours sous l’œil de surveillantes et surveillants pour éviter les blessures, les erreurs de débutants, ces complices des heures tardives toujours prêts à nous donner des conseils pratiques uniques, que seuls des professionnels, des artisans, des amoureux du bois peuvent connaître, partager, diffuser parmi la sciure et les copeaux, dans le vacarme assourdissant des systèmes de ventilation géants.
À chaque fois que j’ai posé une question, en cours théorique comme en laboratoire, à chaque fois que j’ai demandé de l’aide quant à l’utilisation d’un outil ou d’une machine, que j’ai rencontré une difficulté par rapport à certains logiciels de conception architecturale, que j’ai envoyé un MIO pour demander quoi que ce soit, que je me suis préoccupé de l’impact écologique de telle ou telle pratique, à chaque fois j’ai rencontré une oreille attentive, une personne concernée, compétente, qui a su venir sur mon chemin, m’orienter, me rassurer, m’instruire, m’aider à me dépasser. J’ai adoré les cours de prototypage où on apprend à fabriquer des chaises en faisant nous-mêmes nos gabarits, les cours de procédés de finition qui sont comme des cours de peinture classique, ceux de dessins qui ne durent jamais assez longtemps, la gravure numérique et l’impression 3D.
Pourquoi autant d’argent investi en 2020 et 2021 et vouloir vendre le bâtiment en 2027 ? Tout texte est politique. Je le sais. Politique ne veut pas dire polémique.
Nous étudiantes et étudiants avions compris depuis novembre 2023 que la situation de l’ÉNMÉ était critique. Pourtant, nous n’avons pas imaginé qu’une décision radicale serait prise si vite, de manière unilatérale. J’entends bien que l’argument de Victoriaville était de recentraliser ses activités et qu’il ne s’agissait pas vraiment d’une fermeture d’école, qu’il s’agissait d’optimiser le pavillon central, de performer. Mais vu d’ici, à Montréal, pour les élèves, le personnel enseignant, administratif, d’entretien, de maintenance et de surveillance, il s’agissait quand même et il s’agira maintenant pour toujours de la fermeture d’une école, de leur école, de notre école.
Paul-Émile Borduas et Jean-Paul Riopelle sont bien loin.
Je pense aux profs, aux étudiants. En atelier, chacun était responsable de la sécurité de l’autre. Une collègue qui se blessait à côté de vous (peut-être par votre faute) pouvait être une expérience traumatisante. Nous avions toujours intérêt à former une équipe fraternelle pour assurer notre sécurité commune. Je pense à la cohorte dont je ne fais plus partie et qui a présenté ses projets de fin d’études au mois d’avril 2024 au terme de trois années d’efforts, l’avant avant-dernière cohorte d’apprentis selon le calendrier imposé. Chacune et chacun un meuble unique, dessiné par leurs soins exclusivement pour leur DEC, conçu, assemblé et ajusté jusqu’aux derniers instants.
Le bois est une matière vivante, fascinante, qui évolue avec le temps, sensible. Un dialogue s’instaure entre l’humain et la matière. Il faut être à son écoute. Il faut la connaître, la comprendre, l’apprivoiser, la respecter. L’utiliser avec une conscience écoresponsable. Les savoir-faire des professionnels du monde de l’ébénisterie est précieux. Il en va de même de tous les métiers d’arts.
Le processus d’admission de certains étudiants étrangers est à repenser. Ci-dessus figure mon cursus d’études supérieures. Pourtant, les cours de français, de philosophie et d’anglais ont été des cours obligatoires. J’ai vécu dans plusieurs pays étrangers où la langue officielle était l’anglais, je suis bilingue. J’ai décrit brièvement mon parcours professionnel. Pourtant, les cours de ressources humaines, gestion de production et initiation à l’informatique ont été des cours obligatoires alors que j’ai été formateur numérique dans un grand groupe multimédia côté en bourse dès l’âge de 20 ans. Mes compétences, acquises au cours de plus de deux décennies dans l’univers des communications digitales, n’ont pas été prises en considération. Les sept années à enseigner le journalisme non plus. Il me semble nécessaire de revoir les conditions d’équivalences si une école, quelle qu’elle soit, pense recruter à l’international. J’ai trouvé ce processus dégradant. Et ce n’est pas ce qu’on m’avait annoncé en visitant l’école. Au lieu des quinze heures de cours prévus, je me retrouvais avec trente heures par semaine et sept matières différentes. Comment travailler à côté ? Même si le permis d’études m’octroyait d’office un permis de travail temporaire, comment supporter la fatigue, avoir une vie de famille satisfaisante ? Cette situation a été difficile à vivre, pour moi, mes proches. J’ai connu plusieurs étudiants étrangers qui sont partis en première et deuxième années, déçus, incompris. Bien sûr, on m’a proposé de payer pour passer devant une commission, une pour chaque matière, dont le jury m’aurait probablement octroyé chaque équivalence, mais cette possibilité restait problématique, ne résolvait rien. Ce n’était pas à moi de gérer ça. C’était dévalorisant, encore une fois. Infantilisant, encore une fois. Injuste.
Je comprends l’instauration de l’épreuve uniforme de français pour les personnes migrantes. J’ai adoré mes cours de français, la professeure de l’ÉNMÉ était passionnée, vibrante. Pour être tout à fait honnête, il était même important que j’ai une remise à niveau pour être en mesure de rédiger des dissertations analytiques de 900 mots. Ce sont des cours où j’ai appris beaucoup à propos de la culture québécoise. Découvert des autrices et des auteurs formidables, des textes fondateurs et lumineux. On a lu des livres et regardé des films. On a discuté, échangé. On a ri aussi. J’ai appris beaucoup de l’histoire de la colonisation, ce que je n’aurais pas appris si vite autrement. Mais le reste, les autres cours que j’ai cités, comment dire ? … Non. Ce n’est pas un processus acceptable pour être diplômé au Québec quand on a mon âge et mon parcours. Et on nous apprend que l’ÉNMÉ va fermer tandis qu’on me faisait miroiter un probable futur poste d’enseignant… à l’ÉNMÉ. Non. Ce n’est pas un processus acceptable. Non. Je n’aurai pas mon DEC. Tant pis. Tant pis pour qui exactement ?
Dans un monde futur idéal, j’aime rêver que mes profs continueront d’être profs à l’ÉNMÉ, d’avoir des élèves curieux, attentifs et passionnés, venant de partout dans le monde, de développer le réseau professionnel et estudiantin du quartier où l’ÉNMÉ réside. J’aimerais qu’il y ait 300 élèves par rentrée, que tout le quatrième étage soit rempli et que tous les casiers soient attribués. J’aimerais qu’il y ait foule le midi à la cafétéria, que la joie de vivre continue de retentir sur les lambris de frêne et courir sur les plinthes de chêne rouge, que les ateliers libres d’appoint soient complets matin, midi et soir.
J’aime rêver que l’ÉNMÉ de Montréal vive encore trente ans.
Je rêve.
***